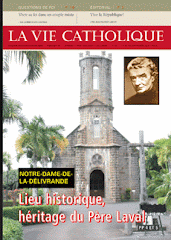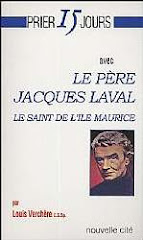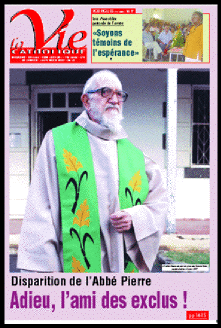 Notons que parmi ceux qui sont venus prier au tombeau du Père Laval à Sainte Croix figurent le Pape Jean Paul II - celui-là même qui l'avait béatifié en 1979 au tout début de son pontificat - et l'Abbé Pierre, lors de la visite de ce dernier dans l'île en 1994.
Notons que parmi ceux qui sont venus prier au tombeau du Père Laval à Sainte Croix figurent le Pape Jean Paul II - celui-là même qui l'avait béatifié en 1979 au tout début de son pontificat - et l'Abbé Pierre, lors de la visite de ce dernier dans l'île en 1994.
1/26/2007
Adieu, l'ami des exclus !
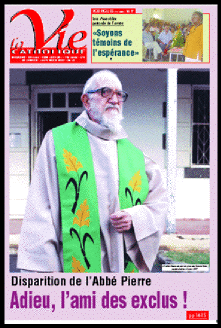 Notons que parmi ceux qui sont venus prier au tombeau du Père Laval à Sainte Croix figurent le Pape Jean Paul II - celui-là même qui l'avait béatifié en 1979 au tout début de son pontificat - et l'Abbé Pierre, lors de la visite de ce dernier dans l'île en 1994.
Notons que parmi ceux qui sont venus prier au tombeau du Père Laval à Sainte Croix figurent le Pape Jean Paul II - celui-là même qui l'avait béatifié en 1979 au tout début de son pontificat - et l'Abbé Pierre, lors de la visite de ce dernier dans l'île en 1994.
11/30/2006
Le Père Laval et les laïcs
Port-Louis, île Maurice, 1843. Le P. Laval appelle et forme des laïcs pour une mission de pionniers qui a implanté l’ÉgliseLe P. Laval arrive à l’île Maurice le 13 septembre 1841.
Aussitôt lui est confiée la Mission des Noirs. À cette époque, l’ambiance était telle que lorsqu’un prêtre s’occupait des Blancs, les Noirs ne s’adressaient pas à lui, et inversement.
Le P. Laval se retrouve bien seul dans son travail. Les circonstances l’amènent à s’adjoindre très vite des laïcs.
En janvier 1843, lui est confié en plus l’enseignement religieux de 400 garçons et filles d’un pensionnat et le service de vicaire, une semaine sur trois. Comment faire pour l’accueil des Noirs qui passent à longueur de journées, dans sa maison en bois ? Il remarque, parmi les nouveaux chrétiens, Édouard Labelle, un créole (descendant d’esclave) seychellois. Il le forme et l’établit comme catéchiste dans son pavillon. C’est un succès.
Dès lors le P. Laval n’a qu’un souci : trouver des catéchistes. Un soir en entrant dans la cathédrale pour le catéchisme, il remarque un homme portant une grosse corde comme ceinture, qui est en prière. Une intuition le traverse : " Voilà un homme qui pourra me rendre de grands services ! " II ne lui dit rien. Il le prépare au baptême, en lui apportant une grande attention. Puis il l’emmène avec lui visiter les gens. Trois ans plus tard, il lui dit : " Émilien, suis Dieu et suis-moi ! " C’est Émilien Pierre, le plus grand catéchiste du P. Laval. Il est envoyé dans de nombreux coins de l’île pour préparer le chemin des missionnaires ou pour les épauler. Il forme d’autres catéchistes.
Une deuxième circonstance. La fille d’un Noir libre (qui n’était pas esclave), Phanie Desfossés, habite à quelques kilomètres de Port-Louis, la capitale. Elle vit sa foi avec ferveur. Phanie désire enseigner le catéchisme aux gens de son village. Le P. Laval accepte. Elle les rassemble, dans le fournil de son père, qui est décédé. Face au succès, le P. Laval vient un jour, en apportant une nappe qu’il étend sur la table, des chandeliers, un crucifix et une statue de la sainte Vierge qu’il place dans la gueule du four. Il bénit cette pièce qui devient la première chapelle du P. Laval.
À cette époque, son catéchisme a tellement de succès que la population de nombreux villages éloignés vient jusqu’à Port-Louis pour se faire instruire et assister à la messe. Les familles qui ont les moyens viennent s’installer quelques années à la ville, pour que leurs enfants soient catéchisés et baptisés. Avec l’expérience de Phanie Desfossés, le P. Laval comprend qu’il faut aller chercher les gens chez eux, en construisant des chapelles dont un catéchiste a la responsabilité.
À partir de ce moment, des chapelles surgissent partout.
Le P. Laval constate, lorsqu’il se rend auprès des mourants, que ceux-ci ne connaissent rien de leur religion. Il confie à des chrétiennes de s’occuper des malades, de leur apprendre les rudiments de la foi et de les préparer à recevoir le sacrement des malades. Elles deviennent aussi catéchistes.
Les deux plus célèbres sont Ma Céleste et Joséphine François. Pendant plus de 20 ans, Ma Céleste enseigne des malades ignorants. Quand elle vient chercher le P. Laval, c’est pour passer chez 4 ou 6 personnes pour leur donner le sacrement des malades.
 Joséphine François habite dans un quartier au sud-ouest de Port-Louis où sont entassés dans des baraques de nombreux pauvres. Elle visite les malades et a un charisme de réconfort. Des familles riches lui demandent de venir réconforter leurs malades. Elle a aussi la charge d’une chapelle avec son mari.Grâce à eux la foi chrétienne s’est répandue dans toute l’île.Grâce à vous les laïcs, la foi chrétienne peut demeurer vivante et s’étendre même s’il n’y a qu’un petit nombre de prêtres.
Joséphine François habite dans un quartier au sud-ouest de Port-Louis où sont entassés dans des baraques de nombreux pauvres. Elle visite les malades et a un charisme de réconfort. Des familles riches lui demandent de venir réconforter leurs malades. Elle a aussi la charge d’une chapelle avec son mari.Grâce à eux la foi chrétienne s’est répandue dans toute l’île.Grâce à vous les laïcs, la foi chrétienne peut demeurer vivante et s’étendre même s’il n’y a qu’un petit nombre de prêtres.
Courage, ne désespérons pas !
P. Louis Verchère
Aussitôt lui est confiée la Mission des Noirs. À cette époque, l’ambiance était telle que lorsqu’un prêtre s’occupait des Blancs, les Noirs ne s’adressaient pas à lui, et inversement.
Le P. Laval se retrouve bien seul dans son travail. Les circonstances l’amènent à s’adjoindre très vite des laïcs.
En janvier 1843, lui est confié en plus l’enseignement religieux de 400 garçons et filles d’un pensionnat et le service de vicaire, une semaine sur trois. Comment faire pour l’accueil des Noirs qui passent à longueur de journées, dans sa maison en bois ? Il remarque, parmi les nouveaux chrétiens, Édouard Labelle, un créole (descendant d’esclave) seychellois. Il le forme et l’établit comme catéchiste dans son pavillon. C’est un succès.
Dès lors le P. Laval n’a qu’un souci : trouver des catéchistes. Un soir en entrant dans la cathédrale pour le catéchisme, il remarque un homme portant une grosse corde comme ceinture, qui est en prière. Une intuition le traverse : " Voilà un homme qui pourra me rendre de grands services ! " II ne lui dit rien. Il le prépare au baptême, en lui apportant une grande attention. Puis il l’emmène avec lui visiter les gens. Trois ans plus tard, il lui dit : " Émilien, suis Dieu et suis-moi ! " C’est Émilien Pierre, le plus grand catéchiste du P. Laval. Il est envoyé dans de nombreux coins de l’île pour préparer le chemin des missionnaires ou pour les épauler. Il forme d’autres catéchistes.
Une deuxième circonstance. La fille d’un Noir libre (qui n’était pas esclave), Phanie Desfossés, habite à quelques kilomètres de Port-Louis, la capitale. Elle vit sa foi avec ferveur. Phanie désire enseigner le catéchisme aux gens de son village. Le P. Laval accepte. Elle les rassemble, dans le fournil de son père, qui est décédé. Face au succès, le P. Laval vient un jour, en apportant une nappe qu’il étend sur la table, des chandeliers, un crucifix et une statue de la sainte Vierge qu’il place dans la gueule du four. Il bénit cette pièce qui devient la première chapelle du P. Laval.
À cette époque, son catéchisme a tellement de succès que la population de nombreux villages éloignés vient jusqu’à Port-Louis pour se faire instruire et assister à la messe. Les familles qui ont les moyens viennent s’installer quelques années à la ville, pour que leurs enfants soient catéchisés et baptisés. Avec l’expérience de Phanie Desfossés, le P. Laval comprend qu’il faut aller chercher les gens chez eux, en construisant des chapelles dont un catéchiste a la responsabilité.
À partir de ce moment, des chapelles surgissent partout.
Le P. Laval constate, lorsqu’il se rend auprès des mourants, que ceux-ci ne connaissent rien de leur religion. Il confie à des chrétiennes de s’occuper des malades, de leur apprendre les rudiments de la foi et de les préparer à recevoir le sacrement des malades. Elles deviennent aussi catéchistes.
Les deux plus célèbres sont Ma Céleste et Joséphine François. Pendant plus de 20 ans, Ma Céleste enseigne des malades ignorants. Quand elle vient chercher le P. Laval, c’est pour passer chez 4 ou 6 personnes pour leur donner le sacrement des malades.
 Joséphine François habite dans un quartier au sud-ouest de Port-Louis où sont entassés dans des baraques de nombreux pauvres. Elle visite les malades et a un charisme de réconfort. Des familles riches lui demandent de venir réconforter leurs malades. Elle a aussi la charge d’une chapelle avec son mari.Grâce à eux la foi chrétienne s’est répandue dans toute l’île.Grâce à vous les laïcs, la foi chrétienne peut demeurer vivante et s’étendre même s’il n’y a qu’un petit nombre de prêtres.
Joséphine François habite dans un quartier au sud-ouest de Port-Louis où sont entassés dans des baraques de nombreux pauvres. Elle visite les malades et a un charisme de réconfort. Des familles riches lui demandent de venir réconforter leurs malades. Elle a aussi la charge d’une chapelle avec son mari.Grâce à eux la foi chrétienne s’est répandue dans toute l’île.Grâce à vous les laïcs, la foi chrétienne peut demeurer vivante et s’étendre même s’il n’y a qu’un petit nombre de prêtres.Courage, ne désespérons pas !
P. Louis Verchère
Jacques-Désiré Laval, un homme à suivre
Toutes races, professions, religions confondues, des milliers de croyants prient toute l’année auprès du Père Laval à Sainte-Croix. Gestes de foi impressionnants !
Port-Louis, 8-9 septembre 2006. Plusieurs centaines de milliers de Mauriciens de toutes religions se pressent autour de l’église Sainte-Croix pour le pèlerinage annuel auprès du Père Laval.
Mgr Piat préside la messe télévisée de 20 h. Il lance, en créole, un vibrant appel pour la solidarité envers les plus démunis, affirmant qu’elle est un devoir de chaque citoyen et non une option. Il demande un soutien impératif aux petites entreprises, une éduction solidaire basée sur un système d’entraide à la place d’une compétition féroce, et un plus grand respect pour les sidéens dans l’éducation et la santé.
Le Père Laval est d’abord médecin chez lui, en Normandie. Spiritain, il travaille à l’île Maurice de 1841 à 1864. Il prend en compte la langue des anciens esclaves et pousse les auxiliaires laïcs à prendre part à son action d’évangélisation. Il meurt épuisé le 9 septembre 1864 à Port-Louis. Le soir de sa mort, une foule nombreuse porte son corps depuis la cathédrale jusqu’à Sainte-Croix où il avait exprimé le désir d’être enterré. Au jour anniversaire de sa mort, une foule encore plus nombreuse refait le même parcours. Depuis, tous les ans avec, chaque fois, plus de monde. Le 22 juin 1972, Paul VI proclame l’héroïcité des vertus du Père Laval. Le 29 avril 1979, Jean-Paul II le proclame Bienheureux.
" Le secret du zèle missionnaire de l’apôtre de Maurice, déclare-t-il, nous le trouvons dans sa sainteté, dans le don de toute sa personne au Christ, inséparable de sa tendresse pour les hommes, surtout les humbles et les plus démunis. Ses paroles toutes simples leur allaient droit au cœur, parce qu’elles venaient d’un cœur modelé sur celui du Christ et rempli d’amour pour eux. Cet amour des pauvres a inspiré toute son action.
"En 1976, M. Domenico Mazzone réalise un buste du Père Laval. Sculptée sur le socle en bois, une croix. S’y accrochent 3 anneaux éclatés, ouverts. Symboles de l’action de libération de l’esclavage réalisé par celui que l’île entière appelle, à la suite du cardinal Margeot, " l’apôtre de l’unité mauricienne dans sa diversité culturelle, raciale, sociale et religieuse ".
Que viennent chercher, aujourd’hui, ces milliers de pèlerins auprès du Père Laval ? Réponses : " la force d’affronter les problèmes de la vie ", " le courage de supporter les souffrances qui ne peuvent guérir ", " la lumière de l’esprit pour guider nos enfants "…
Chaque semaine, près de 6 000 lumignons illuminent son caveau.
 " À travers la prière et par l’intercession du P. Laval, beaucoup de malades du corps, de l’esprit et du cœur ont trouvé le chemin de la guérison ", écrit L’Aurore, le magazine de la Mission catholique chinoise (n° 116, sept. 2006).
" À travers la prière et par l’intercession du P. Laval, beaucoup de malades du corps, de l’esprit et du cœur ont trouvé le chemin de la guérison ", écrit L’Aurore, le magazine de la Mission catholique chinoise (n° 116, sept. 2006).
Une réalité, une évidence que les croyants se redisent les uns aux autres. Le Père Laval continue aujourd’hui de faire du bien. Un fait qui incite celles et ceux qui continuent sa mission d’évangélisation à sortir, à sa suite, les plus pauvres de situations indignes de l’homme.
Louis Verchère
Port-Louis, 8-9 septembre 2006. Plusieurs centaines de milliers de Mauriciens de toutes religions se pressent autour de l’église Sainte-Croix pour le pèlerinage annuel auprès du Père Laval.
Mgr Piat préside la messe télévisée de 20 h. Il lance, en créole, un vibrant appel pour la solidarité envers les plus démunis, affirmant qu’elle est un devoir de chaque citoyen et non une option. Il demande un soutien impératif aux petites entreprises, une éduction solidaire basée sur un système d’entraide à la place d’une compétition féroce, et un plus grand respect pour les sidéens dans l’éducation et la santé.
Le Père Laval est d’abord médecin chez lui, en Normandie. Spiritain, il travaille à l’île Maurice de 1841 à 1864. Il prend en compte la langue des anciens esclaves et pousse les auxiliaires laïcs à prendre part à son action d’évangélisation. Il meurt épuisé le 9 septembre 1864 à Port-Louis. Le soir de sa mort, une foule nombreuse porte son corps depuis la cathédrale jusqu’à Sainte-Croix où il avait exprimé le désir d’être enterré. Au jour anniversaire de sa mort, une foule encore plus nombreuse refait le même parcours. Depuis, tous les ans avec, chaque fois, plus de monde. Le 22 juin 1972, Paul VI proclame l’héroïcité des vertus du Père Laval. Le 29 avril 1979, Jean-Paul II le proclame Bienheureux.
" Le secret du zèle missionnaire de l’apôtre de Maurice, déclare-t-il, nous le trouvons dans sa sainteté, dans le don de toute sa personne au Christ, inséparable de sa tendresse pour les hommes, surtout les humbles et les plus démunis. Ses paroles toutes simples leur allaient droit au cœur, parce qu’elles venaient d’un cœur modelé sur celui du Christ et rempli d’amour pour eux. Cet amour des pauvres a inspiré toute son action.
"En 1976, M. Domenico Mazzone réalise un buste du Père Laval. Sculptée sur le socle en bois, une croix. S’y accrochent 3 anneaux éclatés, ouverts. Symboles de l’action de libération de l’esclavage réalisé par celui que l’île entière appelle, à la suite du cardinal Margeot, " l’apôtre de l’unité mauricienne dans sa diversité culturelle, raciale, sociale et religieuse ".
Que viennent chercher, aujourd’hui, ces milliers de pèlerins auprès du Père Laval ? Réponses : " la force d’affronter les problèmes de la vie ", " le courage de supporter les souffrances qui ne peuvent guérir ", " la lumière de l’esprit pour guider nos enfants "…
Chaque semaine, près de 6 000 lumignons illuminent son caveau.
 " À travers la prière et par l’intercession du P. Laval, beaucoup de malades du corps, de l’esprit et du cœur ont trouvé le chemin de la guérison ", écrit L’Aurore, le magazine de la Mission catholique chinoise (n° 116, sept. 2006).
" À travers la prière et par l’intercession du P. Laval, beaucoup de malades du corps, de l’esprit et du cœur ont trouvé le chemin de la guérison ", écrit L’Aurore, le magazine de la Mission catholique chinoise (n° 116, sept. 2006).Une réalité, une évidence que les croyants se redisent les uns aux autres. Le Père Laval continue aujourd’hui de faire du bien. Un fait qui incite celles et ceux qui continuent sa mission d’évangélisation à sortir, à sa suite, les plus pauvres de situations indignes de l’homme.
Louis Verchère
9/15/2006
Shame !
 Vif mécontentement de la part de nombreux pèlerins à la sortie de Ste-Croix dans la nuit du 8-9 septembre. Bousculade et accrochage verbal entre passagers, receveurs d'autobus individuel, de la United Bus Service et des policiers auraient pu dégénérer sans l'appel au calme de certains.
Vif mécontentement de la part de nombreux pèlerins à la sortie de Ste-Croix dans la nuit du 8-9 septembre. Bousculade et accrochage verbal entre passagers, receveurs d'autobus individuel, de la United Bus Service et des policiers auraient pu dégénérer sans l'appel au calme de certains.La raison : le manque de coordination entre les différents services pour assurer le retour des pèlerins de Ste-Croix vers les gares du Nord et Victoria. Concurrence oblige, certains opérateurs d'autobus ont permis à des passagers au milieu de la file d'attente de prendre place dans leur véhicule, et ce au grand dam de ceux qui attendaient bien avant eux et qui faisaient la queue tranquillement depuis de longues minutes. Tout cela avec la «bénédiction» des policiers qui, au lieu de prendre les actions adéquates pour arrêter cette pratique, l'a laissé perdurer au détriment de ceux qui, par respect et en personnes civilisées, faisaient la queue.
Cette situation a incité d'autres personnes, en fin de file, à envahir les autobus en stationnement avant même qu'ils se placent sur l'arrêt temporaire prévu à cet effet. La grogne était générale et c'est en jouant des épaules et des reins que certains ont pu prendre place dans un bus, avec tous les inconvénients que cela a pu causer.
Ces incidents, déplorables certes à la suite d'un pèlerinage, auraient pu être évités s'il y avait eu une meilleure coordination entre les différents services responsables d'assurer le retour des pèlerins chez eux. Un manque de leadership s'est fait sentir, malgré la présence de quelques hauts gradés de la force policière, rapidement dépassés par les événements. Honte à ceux qui n'ont pas su attendre leur tour en respectant ceux qui ont fait tranquillement la queue pour prendre le bus. Ce genre d'attitude est très éloigné de ce qu'on pouvait espérer des personnes revenant d'un pèlerinage.
La Vie Catholique
Camelote en tous genres
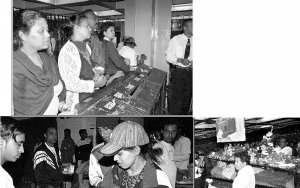
Comme chaque année, le pèlerinage au tombeau du père Laval a attiré son lot de marchands vendant toutes sortes de produits. Hormis les traditionnels marchands de fleurs et de bougies, des gadgets lumineux, des cadres photos avec l'effigie de l'apôtre des Noirs, on a dû compter aussi ceux qui vendaient des boissons alcoolisées, et cela malgré l'interdiction. Un marchand, très prévoyant, n'a rien trouvé de mieux que de proposer des articles...pour Noël !
La Vie Catholique
Mgr Piat : «A la suite de Jésus-Christ et du Père Laval, servez votre pays»
 Cette année, la traditionnelle messe télévisée du Père Laval a été concélébrée par le père Vincent Jauffriot, arrière-arrière-arrière-petit-neveu du Père Laval, et ce, en présence d'autres membres de sa famille. Malgré le froid et la petite pluie fine, une grande foule s'était déplacée à Sainte-Croix. «N'hésitez pas à suivre l'exemple de Jésus-Christ et du Père-Laval», a déclaré Mgr Maurice E. Piat.
Cette année, la traditionnelle messe télévisée du Père Laval a été concélébrée par le père Vincent Jauffriot, arrière-arrière-arrière-petit-neveu du Père Laval, et ce, en présence d'autres membres de sa famille. Malgré le froid et la petite pluie fine, une grande foule s'était déplacée à Sainte-Croix. «N'hésitez pas à suivre l'exemple de Jésus-Christ et du Père-Laval», a déclaré Mgr Maurice E. Piat.Dans son homélie, Mgr Piat a invité l'assistance à ne pas demeurer insensible aux difficultés qui guettent le pays : insécurité créée par la violence ; échec scolaire ; familles éclatées ; enfants de rue ; l'enfer de la drogue et du sida, entre autres. D'où l'importance de se nourrir de l'histoire du Christ et de celle du Père Laval, a-t-il affirmé. Ces derniers, sensibles aux difficultés de leur époque - injustice, corruption, situation sociale tendue - ont pris la décision d'aimer leur peuple fidèlement et ce jusqu'au bout. En quittant confort, statut et profession pour être en empathie avec les opprimés. Leur but était de les empower, rappelle-t-il. «Seul l'amour gratuit, patient, fidèle et désintéressé peut rassembler les gens... Et c'est un amour qui engendre la paix.»
«Vous devez être animés par ce même amour», a précisé l'évêque, afin de pouvoir descendre sur le terrain et aller à la rencontre des enfants analphabètes ; des sidéens et séropositifs ; des sans-abri ; des drogués ; des victimes de la violence. «Pa zis desann, me refiz soutire, refiz capris dimounn.» L'évêque a félicité ces ex-drogués qui, aujourd'hui, aident ceux tombés dans l'enfer de la drogue ; ces séropositifs qui aident d'autres sidéens à vivre leur maladie ; ceux ayant connu des difficultés scolaires et qui se mettent à la disposition des recalés, entre autres.
9/11/2006
Les fidèles venus nombreux malgré le mauvais temps
Père Laval, messe hier soir
Comme c'est le cas depuis 142 ans, les pèlerins sont venus nombreux encore cette année prier le père Laval, à Sainte-Croix. Poussés par leur ferveur, ils ont assisté à la messe de 20h30 en dépit de la froidure de la soirée et de grosses pluies intermittentes.
Un sketch sur l'arrivée de Jacques Désiré Laval, le médecin devenu prêtre pour ensuite consacrer sa vie au peuple de cette île si éloignée de son pays natal, a ouvert la messe. L'on a montré, à travers cette mise en scène dont l'animation vocale a été assurée par l'abbé Jean-Maurice Labour, la situation difficile de Maurice lorsque débarqua le missionnaire français. " Aujourd'hui encore, à Rodrigues comme à Maurice, la société est dans une situation difficile : alcoolisme, drogue, sida etc. Mais il ne faut pas baisser les bras ", devait dire Jean-Maurice Labour.
De son côté, Mgr Maurice Piat, l'évêque de Port-Louis, a, dans son homélie, invité les Mauriciens à suivre l'exemple de père Laval et de Jésus. En dépit du contexte difficile dans lequel ils ont été appelés à offrir leur service, le père Laval, tout comme Jésus ont fait le choix d'aimer le peuple malgré sa corruption. " Jésus savait bien que les autorités voulaient l'éliminer, qu'un de ses apôtres allait le trahir et qu'un autre allait le renier. Mais il a fait le choix d'aimer ce peuple. De même le père Laval, quand il a vu la situation d'injustice et d'oppression à Maurice, par fidélité et par choix il a décidé d'aimer les Mauriciens. " Mgr Piat a indiqué que le père Laval a débarqué dans une indifférence totale mais qu'au moment de sa mort, il fut accompagné de 40 000 personnes de la Cathédrale St-Louis à Ste-Croix.
Invitant les Mauriciens à suivre le chemin de l'apôtre des Mauriciens, il devait le décrire comme quelqu'un s'étant sacrifié pour aider les autres. " Il a quitté sa profession de médecin alors qu'il était issu d'une famille plutôt aisée. Il a recommencé ses études pour devenir prêtre après quoi, il a quitté son pays pour venir habiter à Maurice dans une petite cabane et se mettre au même niveau que les petites gens. " Toutefois, poursuit-il, " père Laval leur a fait comprendre qu'eux aussi se devaient de rendre service aux autres. Il a d'ailleurs reçu beaucoup d'auxiliaires ".
Évoquant les " épreuves difficiles " par lesquelles passe le pays en ce moment - vol, viol, problèmes économiques, violence, enfants de rue et drogue - il a déclaré que " quelle que soit notre religion, nous ne pouvons y rester insensibles ". Il faudrait selon lui, d'abord " aimer notre pays comme l'a fait Père Laval, aimer nos frères et sœurs indépendamment de sa race ". Ensuite, comme un message aux décideurs, " nous devons descendre de nos trônes pour aller à la rencontre des enfants qui ne savent lire, les malades du sida, les sans-abri, les drogués ". " Même si nous n'en avons pas l'occasion, il faut au moins nous y intéresser. " Il a, en outre, demandé aux Ong de ne pas hésiter à faire appel au service des membres de la société civile et des jeunes. Il a ensuite remercié les "enfants de Père Laval" qui se consacrent déjà aux souffrances de ceux qui sont dans la détresse.
La messe a été animée par la chorale de la cathédrale Saint-Louis. Rappelons que ce matin, à 10 h, une messe sera célébrée par l'abbé Jacques-Henri David à Ste-Croix.
Pèlerins : " Chaque année, sans faute "
R. S., la cinquantaine, est venue de Flacq avec son mari, assister à la messe d'hier soir. Ils ont quitté Flacq à 17h pour arriver à Ste-Croix à 18h40. Ils ont voyagé par le bus, comme tous les ans, surtout depuis que le mari a eu un accident de moto il y a quinze ans.
" Aujourd'hui, jour pour jour, cela fait quinze ans. Mon époux était grièvement blessé et ne pouvait marcher pendant cinq ans. Nous avons prié le père Laval et y sommes venus souvent. Il a beaucoup fait pour nous. Aujourd'hui, nous sommes venus le prier encore ", confie notre interlocutrice.
T.H, 55 ans, est de Belle-Étoile. Elle est venue en famille. " Nous venons ici chaque année sans faute. J'ai beaucoup de foi dans le père Laval. Ma fille est handicapée. Père Laval m'a aidée à accepter son handicap. "
Le Mauricien, Le 9 septembre 2006
Comme c'est le cas depuis 142 ans, les pèlerins sont venus nombreux encore cette année prier le père Laval, à Sainte-Croix. Poussés par leur ferveur, ils ont assisté à la messe de 20h30 en dépit de la froidure de la soirée et de grosses pluies intermittentes.
Un sketch sur l'arrivée de Jacques Désiré Laval, le médecin devenu prêtre pour ensuite consacrer sa vie au peuple de cette île si éloignée de son pays natal, a ouvert la messe. L'on a montré, à travers cette mise en scène dont l'animation vocale a été assurée par l'abbé Jean-Maurice Labour, la situation difficile de Maurice lorsque débarqua le missionnaire français. " Aujourd'hui encore, à Rodrigues comme à Maurice, la société est dans une situation difficile : alcoolisme, drogue, sida etc. Mais il ne faut pas baisser les bras ", devait dire Jean-Maurice Labour.
De son côté, Mgr Maurice Piat, l'évêque de Port-Louis, a, dans son homélie, invité les Mauriciens à suivre l'exemple de père Laval et de Jésus. En dépit du contexte difficile dans lequel ils ont été appelés à offrir leur service, le père Laval, tout comme Jésus ont fait le choix d'aimer le peuple malgré sa corruption. " Jésus savait bien que les autorités voulaient l'éliminer, qu'un de ses apôtres allait le trahir et qu'un autre allait le renier. Mais il a fait le choix d'aimer ce peuple. De même le père Laval, quand il a vu la situation d'injustice et d'oppression à Maurice, par fidélité et par choix il a décidé d'aimer les Mauriciens. " Mgr Piat a indiqué que le père Laval a débarqué dans une indifférence totale mais qu'au moment de sa mort, il fut accompagné de 40 000 personnes de la Cathédrale St-Louis à Ste-Croix.
Invitant les Mauriciens à suivre le chemin de l'apôtre des Mauriciens, il devait le décrire comme quelqu'un s'étant sacrifié pour aider les autres. " Il a quitté sa profession de médecin alors qu'il était issu d'une famille plutôt aisée. Il a recommencé ses études pour devenir prêtre après quoi, il a quitté son pays pour venir habiter à Maurice dans une petite cabane et se mettre au même niveau que les petites gens. " Toutefois, poursuit-il, " père Laval leur a fait comprendre qu'eux aussi se devaient de rendre service aux autres. Il a d'ailleurs reçu beaucoup d'auxiliaires ".
Évoquant les " épreuves difficiles " par lesquelles passe le pays en ce moment - vol, viol, problèmes économiques, violence, enfants de rue et drogue - il a déclaré que " quelle que soit notre religion, nous ne pouvons y rester insensibles ". Il faudrait selon lui, d'abord " aimer notre pays comme l'a fait Père Laval, aimer nos frères et sœurs indépendamment de sa race ". Ensuite, comme un message aux décideurs, " nous devons descendre de nos trônes pour aller à la rencontre des enfants qui ne savent lire, les malades du sida, les sans-abri, les drogués ". " Même si nous n'en avons pas l'occasion, il faut au moins nous y intéresser. " Il a, en outre, demandé aux Ong de ne pas hésiter à faire appel au service des membres de la société civile et des jeunes. Il a ensuite remercié les "enfants de Père Laval" qui se consacrent déjà aux souffrances de ceux qui sont dans la détresse.
La messe a été animée par la chorale de la cathédrale Saint-Louis. Rappelons que ce matin, à 10 h, une messe sera célébrée par l'abbé Jacques-Henri David à Ste-Croix.
Pèlerins : " Chaque année, sans faute "
R. S., la cinquantaine, est venue de Flacq avec son mari, assister à la messe d'hier soir. Ils ont quitté Flacq à 17h pour arriver à Ste-Croix à 18h40. Ils ont voyagé par le bus, comme tous les ans, surtout depuis que le mari a eu un accident de moto il y a quinze ans.
" Aujourd'hui, jour pour jour, cela fait quinze ans. Mon époux était grièvement blessé et ne pouvait marcher pendant cinq ans. Nous avons prié le père Laval et y sommes venus souvent. Il a beaucoup fait pour nous. Aujourd'hui, nous sommes venus le prier encore ", confie notre interlocutrice.
T.H, 55 ans, est de Belle-Étoile. Elle est venue en famille. " Nous venons ici chaque année sans faute. J'ai beaucoup de foi dans le père Laval. Ma fille est handicapée. Père Laval m'a aidée à accepter son handicap. "
Le Mauricien, Le 9 septembre 2006
Au chevet du Père Laval
Ils affluent. Des milliers d’anonymes venus de toutes les localités. Bravant la pluie fine parfois forte, le vent glacial qui vous perce les tempes. Avec la même ferveur, leurs pas les ont menés au tombeau du Bienheureux Père Laval. C’était hier soir à Sainte-Croix. Moments d’humanité.
«Ayo depi mo vini, mo senti tou mo douler finn ale.» L’histoire de Geeta Jhuree, est celle de nombreux pèlerins. Affligés de souffrances physiques et morales, ces hommes et femmes éprouvés dans leur chair, cherchent le réconfort dans l’effort.
Marcher. Que ce soit en voisin venu de Sainte Croix. Ou de Port-Louis où ils sont descendus après un long trajet en bus de Grand-Gaube, Mare-d’Australia ou Bel-Ombre. Toujours est-il que c’est dans les kilomètres qui s’enchaînent, dans la lutte contre les intempéries que les pèlerins tirent leur satisfaction.
Rester à la maison un 8 septembre ? Impensable pour Denise Fourneau. «Mo pou fatige, mo pou strese.» Qui a dit que le home sweet home c’était fait pour ne plus penser à rien. Comment? Ne pas penser à prendre son parapluie, son gros pull, ses gouttes pour les yeux, un fichu pour ses cheveux, le livre de prière et un paquet de biscuits Marie, «pou mo ti zanfan ki finn vinn ar moi kapav manze».
Malades, les pèlerins ont des égards pour le prêtre béatifié comme ceux que l’on a pour quelqu’un qui serait en mauvaise santé. Car à son chevet, ils font silence. Des panneaux placés bien en évidence font passer le message haut et fort. Le service d’ordre est lui aussi bien visible, qu’il soit volontaire ou policier.
Avec des gestes étudiées, on s’approche pour tendre sa bougie, son petit bouquet de fleurs au préposé qui se charge de mettre en contact ces objets avec le gisant du Père Laval.
Comme des cadeaux que l’on porte à un malade, ces objets ont une double portée : faire plaisir à celui qui «reçoit» et soulager celui qui offre. Lui donner la sensation d’avoir tout fait dans les normes.
La «norme» : surtout ne pas rater le pèlerinage. Aucune excuse n’est admise à part un cas de force majeure. Une visite au sanctuaire qui prend aussi des allures de délivrance. Comme celle vécue par Roselyne Lefort de Grand-Gaube.
Pendant 24 ans, sa vie a été celle de la mère d’une fille atteinte d’un handicap physique. «Mo pa ti kapav sorti ditou, ti bizin okip li». Et puis, voilà trois ans, la fille de Roselyne décède. C’est sûr, la peine est là. L’absence de l’être cher est là. Mais depuis trois ans, c’est aussi à un autre rythme que vit cette mère. Cela fait donc trois ans qu’elle a repris le chemin de Sainte Croix où elle n’était pas revenue depuis si longtemps.
Bougies et fleurs
Au fil des regards croisés en chemin, la ferveur a tous les visages. Celui de ces adolescentes de Sainte-Croix qui avec leur tante, marchent d’abord jusqu’à Terre-Rouge, pour revenir à pied au tombeau. C’est qu’à 16 ans, les permissions pour sortir sont dures à obtenir pour Davina, Tessa, Karine et Adasha.
Sorte de pendant : les enfants de chœur de Notre-Dame de Fatima. Ces jeunes hommes nageant dans des t-shirt de sport en nylon tiennent un peu gauchement, qui son bouquet de fleurs, qui sa demi-douzaine de bougies. S’ils ont déjà lorgné du côté des marchands de boulettes et de mines qui ont envahi les rues menant au tombeau ( transformant les lieux en sorte de grande kermesse), ces enfants de chœur se tiennent pour l’instant à carreau.
En plus d’être «la communion avec les chrétiens», le pèlerinage est aussi une occasion de se retrouver entre potes, le «fun» d’être en bande, de se taquiner, de se pousser du coude, de «get sa 35 la». Nulle obligation, c’est le «plan» qu’il ne faut pas rater. «J’étais en retard au rendez-vous et les autres n’étaient pas contents», confie Olivier Ami, meneur du ce groupe de Trou-aux-Biches.
Et puis, comme chaque année, il y a ceux qui ont traversé l’océan. Ces «pèlerins» arrivés là par curiosité. Parce qu’ils en ont entendu parler par des proches, des connaissances. C’est le cas de Pradeep Chatterjee. Cet Indien de Delhi, consultant pour le compte de la Road Development Authority (RDA) a entendu parler du pèlerinage par ses collègues de bureau. Alors, avec sa femme Bulbul, ils ont voulu en savoir plus sur ce déplacement de foule.
Père Laval, une vie un exemple
Chargé de l’apostolat des Noirs, le Père Jacques Désiré Laval (1803-1864) fut, pendant les 23 dernières années de sa vie, missionnaire à l’île Maurice. Il quitta Pinterville en Normandie le 23 février 1841, arriva à Londres le 14 mai et s’embarqua, les mains vides, sur le «Tanjore» le 4 juin 1841. Il ne reverrait plus l’Europe. Dès son arrivée il se met à l’apprentissage du créole, enseigne un catéchisme de base et repère parmi les affranchis, un petit groupe qu’il forme pour devenir ses aides. Il fit pour les esclaves, à midi une messe spéciale, du jamais vu à l’époque.
Ce fut considéré comme un acte héroïque. Le Père Laval eut beaucoup de peine à obtenir la permission de laisser entrer les «Noirs» à l’église. La mentalité de l’époque voulait que l’Eglise ne soit pas faite pour «ces» gens-là. Le missionnaire lui, leur rendait visite dans leur hutte, à l’hôpital et en prison. Il guérit physiquement et moralement un peuple de marginaux. Malade à la fin de sa vie et après avoir été frappé par des attaques d’apoplexie, il mourut le vendredi 9 septembre 1864.
Quand le dimanche suivant, à onze heures du matin, on ferma son cercueil, 20 000 personnes avaient défilé devant le corps. Quarante mille personnes l’escortèrent jusqu’à sa dernière demeure. Le Père Jacques-Désiré Laval fut béatifié par le pape Jean-Paul II le 29 avril 1979, en la basilique Saint-Pierre de Rome.
Aline GROËME, l'Express, samedi 8 septembre 2006
«Ayo depi mo vini, mo senti tou mo douler finn ale.» L’histoire de Geeta Jhuree, est celle de nombreux pèlerins. Affligés de souffrances physiques et morales, ces hommes et femmes éprouvés dans leur chair, cherchent le réconfort dans l’effort.
Marcher. Que ce soit en voisin venu de Sainte Croix. Ou de Port-Louis où ils sont descendus après un long trajet en bus de Grand-Gaube, Mare-d’Australia ou Bel-Ombre. Toujours est-il que c’est dans les kilomètres qui s’enchaînent, dans la lutte contre les intempéries que les pèlerins tirent leur satisfaction.
Rester à la maison un 8 septembre ? Impensable pour Denise Fourneau. «Mo pou fatige, mo pou strese.» Qui a dit que le home sweet home c’était fait pour ne plus penser à rien. Comment? Ne pas penser à prendre son parapluie, son gros pull, ses gouttes pour les yeux, un fichu pour ses cheveux, le livre de prière et un paquet de biscuits Marie, «pou mo ti zanfan ki finn vinn ar moi kapav manze».
Malades, les pèlerins ont des égards pour le prêtre béatifié comme ceux que l’on a pour quelqu’un qui serait en mauvaise santé. Car à son chevet, ils font silence. Des panneaux placés bien en évidence font passer le message haut et fort. Le service d’ordre est lui aussi bien visible, qu’il soit volontaire ou policier.
Avec des gestes étudiées, on s’approche pour tendre sa bougie, son petit bouquet de fleurs au préposé qui se charge de mettre en contact ces objets avec le gisant du Père Laval.
Comme des cadeaux que l’on porte à un malade, ces objets ont une double portée : faire plaisir à celui qui «reçoit» et soulager celui qui offre. Lui donner la sensation d’avoir tout fait dans les normes.
La «norme» : surtout ne pas rater le pèlerinage. Aucune excuse n’est admise à part un cas de force majeure. Une visite au sanctuaire qui prend aussi des allures de délivrance. Comme celle vécue par Roselyne Lefort de Grand-Gaube.
Pendant 24 ans, sa vie a été celle de la mère d’une fille atteinte d’un handicap physique. «Mo pa ti kapav sorti ditou, ti bizin okip li». Et puis, voilà trois ans, la fille de Roselyne décède. C’est sûr, la peine est là. L’absence de l’être cher est là. Mais depuis trois ans, c’est aussi à un autre rythme que vit cette mère. Cela fait donc trois ans qu’elle a repris le chemin de Sainte Croix où elle n’était pas revenue depuis si longtemps.
Bougies et fleurs
Au fil des regards croisés en chemin, la ferveur a tous les visages. Celui de ces adolescentes de Sainte-Croix qui avec leur tante, marchent d’abord jusqu’à Terre-Rouge, pour revenir à pied au tombeau. C’est qu’à 16 ans, les permissions pour sortir sont dures à obtenir pour Davina, Tessa, Karine et Adasha.
Sorte de pendant : les enfants de chœur de Notre-Dame de Fatima. Ces jeunes hommes nageant dans des t-shirt de sport en nylon tiennent un peu gauchement, qui son bouquet de fleurs, qui sa demi-douzaine de bougies. S’ils ont déjà lorgné du côté des marchands de boulettes et de mines qui ont envahi les rues menant au tombeau ( transformant les lieux en sorte de grande kermesse), ces enfants de chœur se tiennent pour l’instant à carreau.
En plus d’être «la communion avec les chrétiens», le pèlerinage est aussi une occasion de se retrouver entre potes, le «fun» d’être en bande, de se taquiner, de se pousser du coude, de «get sa 35 la». Nulle obligation, c’est le «plan» qu’il ne faut pas rater. «J’étais en retard au rendez-vous et les autres n’étaient pas contents», confie Olivier Ami, meneur du ce groupe de Trou-aux-Biches.
Et puis, comme chaque année, il y a ceux qui ont traversé l’océan. Ces «pèlerins» arrivés là par curiosité. Parce qu’ils en ont entendu parler par des proches, des connaissances. C’est le cas de Pradeep Chatterjee. Cet Indien de Delhi, consultant pour le compte de la Road Development Authority (RDA) a entendu parler du pèlerinage par ses collègues de bureau. Alors, avec sa femme Bulbul, ils ont voulu en savoir plus sur ce déplacement de foule.
Père Laval, une vie un exemple
Chargé de l’apostolat des Noirs, le Père Jacques Désiré Laval (1803-1864) fut, pendant les 23 dernières années de sa vie, missionnaire à l’île Maurice. Il quitta Pinterville en Normandie le 23 février 1841, arriva à Londres le 14 mai et s’embarqua, les mains vides, sur le «Tanjore» le 4 juin 1841. Il ne reverrait plus l’Europe. Dès son arrivée il se met à l’apprentissage du créole, enseigne un catéchisme de base et repère parmi les affranchis, un petit groupe qu’il forme pour devenir ses aides. Il fit pour les esclaves, à midi une messe spéciale, du jamais vu à l’époque.
Ce fut considéré comme un acte héroïque. Le Père Laval eut beaucoup de peine à obtenir la permission de laisser entrer les «Noirs» à l’église. La mentalité de l’époque voulait que l’Eglise ne soit pas faite pour «ces» gens-là. Le missionnaire lui, leur rendait visite dans leur hutte, à l’hôpital et en prison. Il guérit physiquement et moralement un peuple de marginaux. Malade à la fin de sa vie et après avoir été frappé par des attaques d’apoplexie, il mourut le vendredi 9 septembre 1864.
Quand le dimanche suivant, à onze heures du matin, on ferma son cercueil, 20 000 personnes avaient défilé devant le corps. Quarante mille personnes l’escortèrent jusqu’à sa dernière demeure. Le Père Jacques-Désiré Laval fut béatifié par le pape Jean-Paul II le 29 avril 1979, en la basilique Saint-Pierre de Rome.
Aline GROËME, l'Express, samedi 8 septembre 2006
9/08/2006
Père Laval : un rassembleur
Une photo de Marie à côté du dieu Ganesh. La photo du Père Laval côtoyant celle de Ram. Ce mélange du genre se voit très souvent dans les cabines d'autobus, plus particulièrement d'opérateurs privés. Des hindous ou tamouls au tombeau du Bx Père Laval. Que faut-il en penser ?
Dans le kalimaye de deux mètres carrés de la famille M, les divinités du panthéon hindou cohabitent avec les images pieuses des saints. Et dans la voiture familiale, saint Christophe partage une place de choix sur le tableau de bord.
Balraj ne voit aucune contradiction dans son attitude religieuse. «Mo prie tou, lance-t-il en guise d'explication. Mo kroir ki zot tou kapav beni mwa.» Des prières que la famille récite matin et soir.
«Mo prie tou»
Chez les A., famille marathie portlouisienne, il est de coutume, chaque année, de marquer certains événements du calendrier chrétien. Entre autres, la participation aux quarante heures et la prière au tombeau du Bx Père Laval, plusieurs jours après la commémoration de l'anniversaire de sa mort. Cette tradition perdure aujourd'hui parmi les enfants mariés, pères et mères de famille.
Ainsi, B., le benjamin des fils, la quarantaine aujourd'hui, fait année après année, le déplacement vers Sainte-Croix.
«J'aime bien le cadre ; il est reposant, propice à la prière et j'ai la conviction que mes prières sont entendues. Au fond, je pense que cette démarche me ramène aussi à l'enfance....» Décortiquer davantage sa démarche lui est difficile.
Un leadership qui marque
Pour le pandit Youdhisteer Munbodh, le «community leadership» des religieux de l'époque coloniale est pour beaucoup dans la démarche plurielle des hindous.
«J'ai fréquenté l'école catholique de Notre-Dame-du-Grand-Pouvoir. Les prêtres et religieuses Filles de Marie, des modèles, m'ont motivé à l'ouverture.»
Au point qu'aujourd'hui, le pandit Mundodh avoue avoir «adopté la pluralité, tout en gardant, avec conviction, son identité religieuse et culturelle hindoue.»
De plus, poursuit notre interlocuteur, «l'hindouisme est une religion tolérante, reposant sur des valeurs démocratiques telles que la liberté des religions et l'ouverture.»
L'école néo-hindouiste qui émerge fait que «sur une même plateforme, on peut trouver les valeurs chrétiennes, bouddhistes...» Une tolérance que notre interlocuteur remonte d'ailleurs «dans le Vasudev Kuttum Nakam, livre védique de l'Inde millénaire.»
L'utilisation de plus en plus répandue de la langue créole par les chrétiens est aussi une des raisons qu'avance le pandit Munbodh pour expliquer l'appropriation de certaines notions chrétiennes par les hindous.
«Le créole a définitivement facilité le passage et permis que des hindous se sentent à l'aise dans les rites chrétiens.»
Pour un plural mind-set
Aujourd'hui encore, cette influence chrétienne est toujours présente dans la vie du pandit Munbodh. Quand il passe devant une grotte, une chapelle ou une église, il ne manque pas silencieusement de réciter le Notre Père appris pendant l'enfance.
Ce «plural mind-set» est, de l'avis de notre interlocuteur, crucial dans un pays de diversité culturelle et religieuse comme le nôtre.
«Si nous voulons renforcer le nation-bui
lding, il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'autre. C'est une démarche essentielle à faire pour la stabilité sociale, la paix et l'unité sociale.»
C'est d'ailleurs toujours avec un réel plaisir qu'il enfile kurta et dhoti pour aller prêcher, dans nos églises, l'ouverture et la tolérance.
Ce va-et-vient incessant d'une religion à une autre est le propre de la religion populaire, explique Danielle Palmyre-Florigny, docteur en théologie.
«La religion populaire ne connaît pas de frontière, de cloisonnement et échappe au cadre institutionnel avec ses dogmes définits et ses rites précis... On pourrait dire que le pilier de cette religion est le système de recours. A l'exemple du malade, celui qui pratique la religion populaire va essayer différents rituels, naviguer entre différentes religions, fréquenter la pagode, le traiteur, s'adresser aux divinités hindoues, aux saints chrétiens irrespectivement jusqu'à ce qu'il trouve une solution à ses problèmes.»
Père Laval : un «grand gourou»
Dans ce contexte, le Père Laval a une place particulière dans la religion populaire. Il est un «grand gourou avec des facultés surnaturelles qui émanent du divin», avoue le Pandit Mundodh.
Et Danielle Florigny d'ajouter : «Le Père Laval est aux yeux des Mauriciens un 'saint'. Il est médecin ; donc capable de guérir les blessures et maladies. Il a déjà fait des miracles. Son œuvre à Maurice en fait une figure locale qui attire au point que différentes communautés et religions se l'approprient sans difficulté.»
Peut-on donc parler de syncrétisme ? Une définition d'abord de ce terme d'aprés Théo, l'encyclopédie catholique qui en fait «est une combinaison plus ou moins artificielle et superficielle d'éléments appartenant à diverses doctrines religieuses, combinaison le plus souvent réalisée dans le désir de parvenir à une unification religieuse.»
Le syncrétisme est un terme forgé par les observateurs extérieurs et les autorités des religions instituées, explique Danielle Florigny. Mais si on se place sur le registre anthropologique, la personne est cohérente et logique dans sa démarche. Une démarche liée à l'affectivité, aux expériences qu'elle vit et à sa quête de remède, de solution à ses souffrances et à ses malheurs.
Danièle Babooram, La vie Catholique
Dans le kalimaye de deux mètres carrés de la famille M, les divinités du panthéon hindou cohabitent avec les images pieuses des saints. Et dans la voiture familiale, saint Christophe partage une place de choix sur le tableau de bord.
Balraj ne voit aucune contradiction dans son attitude religieuse. «Mo prie tou, lance-t-il en guise d'explication. Mo kroir ki zot tou kapav beni mwa.» Des prières que la famille récite matin et soir.
«Mo prie tou»
Chez les A., famille marathie portlouisienne, il est de coutume, chaque année, de marquer certains événements du calendrier chrétien. Entre autres, la participation aux quarante heures et la prière au tombeau du Bx Père Laval, plusieurs jours après la commémoration de l'anniversaire de sa mort. Cette tradition perdure aujourd'hui parmi les enfants mariés, pères et mères de famille.
Ainsi, B., le benjamin des fils, la quarantaine aujourd'hui, fait année après année, le déplacement vers Sainte-Croix.
«J'aime bien le cadre ; il est reposant, propice à la prière et j'ai la conviction que mes prières sont entendues. Au fond, je pense que cette démarche me ramène aussi à l'enfance....» Décortiquer davantage sa démarche lui est difficile.
Un leadership qui marque
Pour le pandit Youdhisteer Munbodh, le «community leadership» des religieux de l'époque coloniale est pour beaucoup dans la démarche plurielle des hindous.
«J'ai fréquenté l'école catholique de Notre-Dame-du-Grand-Pouvoir. Les prêtres et religieuses Filles de Marie, des modèles, m'ont motivé à l'ouverture.»
Au point qu'aujourd'hui, le pandit Mundodh avoue avoir «adopté la pluralité, tout en gardant, avec conviction, son identité religieuse et culturelle hindoue.»
De plus, poursuit notre interlocuteur, «l'hindouisme est une religion tolérante, reposant sur des valeurs démocratiques telles que la liberté des religions et l'ouverture.»
L'école néo-hindouiste qui émerge fait que «sur une même plateforme, on peut trouver les valeurs chrétiennes, bouddhistes...» Une tolérance que notre interlocuteur remonte d'ailleurs «dans le Vasudev Kuttum Nakam, livre védique de l'Inde millénaire.»
L'utilisation de plus en plus répandue de la langue créole par les chrétiens est aussi une des raisons qu'avance le pandit Munbodh pour expliquer l'appropriation de certaines notions chrétiennes par les hindous.
«Le créole a définitivement facilité le passage et permis que des hindous se sentent à l'aise dans les rites chrétiens.»
Pour un plural mind-set
Aujourd'hui encore, cette influence chrétienne est toujours présente dans la vie du pandit Munbodh. Quand il passe devant une grotte, une chapelle ou une église, il ne manque pas silencieusement de réciter le Notre Père appris pendant l'enfance.
Ce «plural mind-set» est, de l'avis de notre interlocuteur, crucial dans un pays de diversité culturelle et religieuse comme le nôtre.
«Si nous voulons renforcer le nation-bui
lding, il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'autre. C'est une démarche essentielle à faire pour la stabilité sociale, la paix et l'unité sociale.»
C'est d'ailleurs toujours avec un réel plaisir qu'il enfile kurta et dhoti pour aller prêcher, dans nos églises, l'ouverture et la tolérance.
Ce va-et-vient incessant d'une religion à une autre est le propre de la religion populaire, explique Danielle Palmyre-Florigny, docteur en théologie.
«La religion populaire ne connaît pas de frontière, de cloisonnement et échappe au cadre institutionnel avec ses dogmes définits et ses rites précis... On pourrait dire que le pilier de cette religion est le système de recours. A l'exemple du malade, celui qui pratique la religion populaire va essayer différents rituels, naviguer entre différentes religions, fréquenter la pagode, le traiteur, s'adresser aux divinités hindoues, aux saints chrétiens irrespectivement jusqu'à ce qu'il trouve une solution à ses problèmes.»
Père Laval : un «grand gourou»
Dans ce contexte, le Père Laval a une place particulière dans la religion populaire. Il est un «grand gourou avec des facultés surnaturelles qui émanent du divin», avoue le Pandit Mundodh.
Et Danielle Florigny d'ajouter : «Le Père Laval est aux yeux des Mauriciens un 'saint'. Il est médecin ; donc capable de guérir les blessures et maladies. Il a déjà fait des miracles. Son œuvre à Maurice en fait une figure locale qui attire au point que différentes communautés et religions se l'approprient sans difficulté.»
Peut-on donc parler de syncrétisme ? Une définition d'abord de ce terme d'aprés Théo, l'encyclopédie catholique qui en fait «est une combinaison plus ou moins artificielle et superficielle d'éléments appartenant à diverses doctrines religieuses, combinaison le plus souvent réalisée dans le désir de parvenir à une unification religieuse.»
Le syncrétisme est un terme forgé par les observateurs extérieurs et les autorités des religions instituées, explique Danielle Florigny. Mais si on se place sur le registre anthropologique, la personne est cohérente et logique dans sa démarche. Une démarche liée à l'affectivité, aux expériences qu'elle vit et à sa quête de remède, de solution à ses souffrances et à ses malheurs.
Danièle Babooram, La vie Catholique
Danielle Florigny : «Le Père Laval a fait un remarquable travail social, mais pas une vraie émancipation sociale»
Les Mauriciens, toutes classes sociales confondues, vont se rendre en grand nombre, ce week-end, au tombe au du Bx Père Laval. Le point avec Danielle Palmyre-Florigny, Docteur en théolgie et responsable de l'Institut catholique de l'île Maurice (ICIM).
En quoi peut-on dire que le Père Laval est un modèle pour nous aujourd'hui ?
Je pense, entre autres, à son ouverture ; au fait que sa foi l'ait poussé à la rencontre des autres peuples, alors qu'il était Français.
Il en est de même de sa façon humaine d'aborder sa mission à Maurice. Le Père Laval a pris en compte la langue des anciens esclaves, accomplissant un vrai travail de contact et d'évangélisation.
Il a aussi fait confiance aux laïcs et les a poussés à assumer leurs responsabilités dans les communautés chrétiennes. Nous savons tous le rôle joué par les auxiliaires du Père Laval auprès des esclaves nouvellement affranchis.
Cependant, on pourrait dire que le Père Laval avait une vision du christianisme conditionnée par son époque. Ainsi, l'intérêt pour la culture de l'autre était motivé par le désir d'assurer son salut. Íl n'a pas toujours bien compris la culture des esclaves et condamnait le séga, par exemple.
Il a fait un remarquable travail social sans toutefois œuvrer pour une vraie émancipation sociale. Dans ce sens, sur certains sujets, le Père Laval n'a pas mené une vraie révolution. On pourrait aussi se demander si c'était bien de son charisme et se dire que ce n'est pas possible de tout changer d'un seul coup...
C'est quoi être saint ? Quel message en retenir ?
Un bienheureux, un saint est quelqu'un qui a une relation très forte avec le Christ. Quelqu'un qui vit une dimension d'amitié et de cœur qui débouche sur la transformation de la vie, l'amène à créer de nouvelles relations et à transformer son environnement proche, si ce n'est la société dans laquelle il vit. Ce, par les valeurs de l'Évangile.
Le Père Laval saint. A quand la réalisation de ce rêve ?
Je ne pense pas qu'il faille se focaliser sur ce sujet. La canonisation, c'est la reconnaissance officielle de l'Église du travail du saint et de son impact positif sur une société, un pays. Mon point de vue est que le travail du Père Laval est là. Il attire chrétiens et non chrétiens et donc les fruits de ce travail sont encore bien palpables aujourd'hui. C'est ça l'important.
Danièle Babooram, La Vie Catholique
En quoi peut-on dire que le Père Laval est un modèle pour nous aujourd'hui ?
Je pense, entre autres, à son ouverture ; au fait que sa foi l'ait poussé à la rencontre des autres peuples, alors qu'il était Français.
Il en est de même de sa façon humaine d'aborder sa mission à Maurice. Le Père Laval a pris en compte la langue des anciens esclaves, accomplissant un vrai travail de contact et d'évangélisation.
Il a aussi fait confiance aux laïcs et les a poussés à assumer leurs responsabilités dans les communautés chrétiennes. Nous savons tous le rôle joué par les auxiliaires du Père Laval auprès des esclaves nouvellement affranchis.
Cependant, on pourrait dire que le Père Laval avait une vision du christianisme conditionnée par son époque. Ainsi, l'intérêt pour la culture de l'autre était motivé par le désir d'assurer son salut. Íl n'a pas toujours bien compris la culture des esclaves et condamnait le séga, par exemple.
Il a fait un remarquable travail social sans toutefois œuvrer pour une vraie émancipation sociale. Dans ce sens, sur certains sujets, le Père Laval n'a pas mené une vraie révolution. On pourrait aussi se demander si c'était bien de son charisme et se dire que ce n'est pas possible de tout changer d'un seul coup...
C'est quoi être saint ? Quel message en retenir ?
Un bienheureux, un saint est quelqu'un qui a une relation très forte avec le Christ. Quelqu'un qui vit une dimension d'amitié et de cœur qui débouche sur la transformation de la vie, l'amène à créer de nouvelles relations et à transformer son environnement proche, si ce n'est la société dans laquelle il vit. Ce, par les valeurs de l'Évangile.
Le Père Laval saint. A quand la réalisation de ce rêve ?
Je ne pense pas qu'il faille se focaliser sur ce sujet. La canonisation, c'est la reconnaissance officielle de l'Église du travail du saint et de son impact positif sur une société, un pays. Mon point de vue est que le travail du Père Laval est là. Il attire chrétiens et non chrétiens et donc les fruits de ce travail sont encore bien palpables aujourd'hui. C'est ça l'important.
Danièle Babooram, La Vie Catholique
Inscription à :
Articles (Atom)